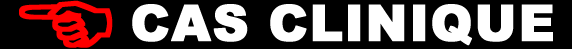Nommer le symptôme
Diagnostic
Nommer le symptôme
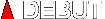
Tamburini en 1890 parlait des “hallucinations motrices verbales des aliénés” pour décrire ces productions verbales parfois proches de la verbigération, mais qui ne sont pas reconnues par le patient comme émanant de soi.
Ce vocable semble ne pas se superposer avec ce que Jules Séglas nommait les “hallucinations psycho-motrices”, puisque pour ces dernières, il semblait comprendre ce que nous entendons actuellement par "hallucinations intra-psychiques" (selon Lanteri-Laura 2002). Pour rappel, les hallucinations psychiques, un terme inventé par Baillarger, aussi appelées intra-psychiques, se différencient des hallucinations psycho-sensorielles (par exemples les hallucinations acoustico-verbales) par l'absence de caractère sensoriel (p. exemple sonore) du phénomène. Certains ont rapproché le terme d'hallucinations intra-psychique de ce que les anglo-saxons nomment le phénomène d'insertion de pensée. Ce rapprochement pose des difficultés car ce dernier phénomène inclus dans les symptômes de premier rang de Schneider est compris comme un délire et non comme un phénomène hallucinatoire. Selon la définition du Kaplan et Sadock (7èm ed – 1994), l'insertion de pensée fait partie des idées délirantes de contrôle (delusion of control) : le patient émet l'idée que des pensées étrangères ont été introduites dans son cerveau.
Dans la classification de WKL, les hallucinations motrice verbales, hors phase d'exacerbation ne s'observent que dans la paraphrénie incohérente et la catatonie inertielle. Dans la première la patiente parle véritablement de façon audible, alors que dans la seconde, la production est quasi inaudible. La seule différence avec la verbigération est alors l'absence de reconnaissance de cette activité ou du matériel comme émanant de soi.
Des enregistrements EMG ont permis d'authentifier chez certains patients la concomitance de la perception des hallucinations avec une activité électrique des muscles pharyngés et une expérience utilisant les laryngophones utilisés par les pilotes pendant la seconde guerre mondiale a pu mettre en rapport le contenu des hallucinations tel que rapporté par le patient avec ce qu'il était possible de percevoir sur l'enregistrement.
Diagnostic
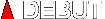
Cette patiente était diagnostiquée de schizophrénie résistante.
L'évolution chronique de symptômes psychotiques. En particulier la présence d'hallucinations avec lesquelles elle conversait. Le fait de parler avec ses voix, dès lors que la durée est suffisante (1 mois pour la CIM, 6 mois pour le DSM), peut suffire à poser le diagnostique en l'absence de tout autre symptôme, après élimination d'un trouble de l'humeur et la démonstration d'un retentissement sur le fonctionnement psycho-social (un résidu des symptômes de premier rang de Schneider).
Certes, il existe des idées sur-investies religieuses et de contrôle (pensait que les démons la possédait), mais ces idées sont partagées avec l'entourage (mère en particulier), et peuvent être critiquées, ce qui selon le DSM ne permet pas de les retenir comme un délire (au moins au jour de l'examen).
Quoi qu'il en soit, le diagnostic de schizophrénie est exacte au sens du DSM et de la CIM.
En revanche le tableau ne correspond à aucun de ceux décrits par l'école de WKL. La logique est épargnée et le contact est bon, ce qui exclu la paraphrénie incohérente et la catatonie inertielle.
Aussi un certains nombre d'arguments nous font discuter la possibilité d'un trouble conversif (tbl dissociatif non spécifie au sens du DSM, autrement dit d'une hystérie en bon français).
- D'abord en raison du caractère démonstratif, la fréquente, voir constante présence de 'spectateurs' au cours des épisodes, renforcé par le contexte culturel et les relations pathologiques entretenues avec la mère.
- La suggestibilité probable des symptômes, induits par la prière et aussi le fait que la patiente ait présenté plus de symptômes lors de la réalisation du film que lors de notre premier entretien.
- Le fait que les production verbales sont adaptées au public : ne parlant pas l'alsacien, je n'ait eut droit qu'à des productions françaises, alors que l'alsacien prédominait à la maison.
- L'absence de traumatisme lors des mouvements pourtant brusques qu'elle pouvait présenter.
- On peut se questionner sur les bénéfices secondaires : faire passer des messages, résoudre des conflits, prendre de l'importance.
- De même la thématique fortement sexuelle est évocatrice.
- La patiente ne se présente pas avec des traits histrioniques marqués, mais on sait qu'un trouble conversif n'est associé à une personnalité histrionique que dans moins d'un tiers des cas. De tels symptômes conversifs chroniques ne s'observent plus guerre que dans un contexte culturel particulier, souvent chez des individus de petit niveau, ce qui le cas de notre patiente.
Comment aller plus loin pour étayer un tel diagnostique ?
S'interroger sur d'autres symptômes conversifs :
- Les somatisations sont fréquentes. On retrouvait effectivement de nombreuses plaintes somatiques, mais elles étaient surtout centrées sur la digestions, or la patiente souffrait d'une rectocolite ulcero-hémorragique.
- Pouvait-on envisager le diagnostic de fuite dissociative pour l'épisode de 89 et d'amnésie dissociative pour l'absence de souvenir ? Les attaques sur les proches sont-elles de même nature ?
- Nous n'avons pas trouvé de trouble de dépersonnalisation chroniques; certes il y avait des épisodes de dépersonnalisation, mais cet état ne persistait pas. Il faut néanmoins noter que ce trouble tien une place à part dans les troubles dissociatifs du DSM. En effet, il s'associe peu fréquemment avec les précédents qui à l'inverse s'associent souvent entre eux, et les facteurs de risque ou précipitant ne sont pas les mêmes (stress chronique pour la dépersonnalisation vs aigu).
- Nous n'avons pas pu objectivé d'hallucinations négatives, peut-être la seule forme d'hallucination qui soit typiquement dissociative et qui ne s'observe pas dans les psychoses. Cependant celles-ci sont difficiles à objectiver et si elles ont une valeur diagnostic positive très forte, elles n'ont aucune valeur quand au diagnostic négatif.
Si ce dernier diagnostique est exacte, le pronostic est mauvais, les symptômes ayant persistés trop longtemps, et étant acceptés par l'entourage.
Pour en finir, nous avions discuté de la polysémie du terme dissociatif, signe (cardial) de la psychose en France, alors qu'aux USA il désigne le principe psychopathologie de ce que nous nommons l'hystérie. Et en effet, l'idée d'origine était la même. A l'époque de Pierre Janet, le père de ce concept, on imaginait que le fonctionnement cérébrale s'expliquait par un enchainement d'idées associées les aunes aux autres par des liens logiques ou liés à l'expérience : les chaines associatives (d'où le refleurissement des techniques faisant appel à l'association libre ou dirigée pour étudier le fonctionnement du cerveau). La dissociation signifiait la rupture de ces chaines associatives. Une rupture qui expliquait aussi bien l'hystérie que la psychose. Ce terme est resté attaché à la seconde chez nous, en particulier suite au syncrétisme de Henry Ey alors qu'il s'est attaché au concept d'hystérie de conversion aux USA. Pour plus d'éléments historiques par rapport à ce concept dans la psychose, cf. chapitre historique thèse J Foucher.